Cycle 1 : Les origines invisibles
Quand les blessures du passé s'impriment dans nos cellules.
Longtemps, j'ai cru que mon anxiété venait uniquement de ma personnalité, de ma manière de penser, et de mon hypersensibilité. Mais plus j'ai commencé à creuser dans mon histoire, plus j'ai compris que mes angoisses portaient des traces plus anciennes, comme un écho venu de loin.
Et si sans le savoir, nous étions les gardiens des blessures de nos ancêtres ? c'est ce que l'épigénétique révèle.
C'est quoi l'épigénétique ?
C'est la science qui étudie la façon dont notre environnement ,nos émotions, ou encore les évènements que nous traversons peuvent influencer l'expression de nos gènes sans modifier notre ADN lui même.
Nos gènes, c'est un peu comme la grande bibliothèque de notre corps et dans cette bibliothèque il y a des milliers de livres : ce sont les gènes. Ces livres contiennent les instructions qui font de chacun de nous une personne unique (la couleur des yeux, notre système immunitaire, notre sensibilité ...)
Mais tous les livres ne sont pas ouverts en même temps, certains sont "lus" d'autres restent fermés comme s'ils étaient rangés sur une étagère par exemple.
Ce qui décide de les ouvrir ou non, ce sont des interrupteurs invisibles dans notre corps, ces interrupteurs réagissent à ce que nous vivons : le stress, la peur, un traumatisme mais aussi la tendresse, la sécurité, la confiance.
Quand la vie est douce, certains gènes du stress peuvent "s'éteindre", et quand la vie est dure, ils peuvent "s'allumer' pour nous aider à nous protéger.
Parfois ces réglages peuvent se transmettre, un peu comme si les émotions ou les blessures d'une génération laissaient une trace dans le corps de la suivante sans que les gènes changent.
L'épigénétique nous aide à comprendre comment ce que nos parents ou nos grands parents ont traversé peut parfois laisser une empreinte dans la façon dont notre corps réagit aujourd'hui, c'est une mémoire qui ne passe pas par les mots, mais par le corps.
Des études menées sur les descendants de guerres, de déportations ou de famines ont montré que beaucoup présentaient une réponse au stress plus forte, un système nerveux plus réactif et une tendance à l'hypervigilance. Leur organisme semblait préparé à affronter un danger, même quand ce danger n'existait plus, c'est comme si l'histoire de leurs ancêtres s'était imprimée dans leur biologie en leur chuchotant : "Sois prudent. Sois prêt".
Bien sûr tout ne se résume pas à la génétique.
Notre environnement, notre éducation, nos choix de vie jouent un rôle immense.
Mais comprendre cette dimension invisible, c'est déjà enlever un peu de culpabilité à ceux qui se sentent "trop anxieux" sans raison apparente.

Quand je regarde ma famille.
Quand je regarde ma famille, je vois des visages marqués par le courage et la peur mêlés. Des regards qui en disent long, mais des mots qui ne viennent pas, deux grands pères profondément abîmés par la guerre, des hommes revenus vivants, oui, mais à quel prix ?
Derrière leurs silences, leurs colères parfois, ou leur besoin de tout contrôler, il y avait cette peur que tout recommence.
Ma mère a grandi auprès d'un père meurtri, dans une maison où l'on ne parlait pas de ce que l'on ressentait. Alors elle a fait semblant de faire comme si tout allait bien, et moi je l'observais. Petite, je sentais déjà ses angoisses jusque dans mon ventre mais je ne les comprenais pas.
Je pensais que c'était ça être adulte : tenir coûte que coûte, cacher, ne pas déranger.
Mon père portait la même inquiétude, la même tension intérieure c'était un homme travailleur, sensible et souvent inquiet, marqué par la peur du manque et par ce besoin qu'il avait de tout maitriser. Une vigilance que je connais bien à mon tour, une sorte de peur sourde de ce qui pourrait arriver et qu'il m'a transmise involontairement.
Aujourd'hui je comprends que cette anxiété n'est pas née de nulle part, elle a traversé les générations avant d'arriver jusqu'à moi.
Le temps est venu enfin de la regarder autrement, pas comme une ennemie mais comme une mémoire vivante qui ne demande qu'à être apaisée.
Dans ce regard posé sur ma famille il y a de la tendresse et beaucoup de reconnaissance, parce que même dans leurs silences et leurs blessures, ils m'ont transmis le courage d'essayer encore et encore ...
Les paroles des autres (de ceux qui ne comprennent pas).
"C'est parce qu'il s'ennuie, il devrait se bouger un peu plus" ; "Mais portant elle a tout pour elle..."; "Il est toujours a ruminer, c'est pénible à la fin "; "Mais pourquoi elle n'arrive pas à être heureuse ...? " C'est pas en ruminant le passé sans cesse qu'il ira mieux" ; "On ne peut rien lui dire, elle se fâche tellement vite" ; "On ne comprend rien, il a tout pour être heureux " ...
Enfant j'ai souvent entendu ces mots dans les conversations de famille, les repas du dimanche, les discussions à voix basse que les intéressés surprenaient malheureusement toujours, alors certes, ils ne m'étaient pas destinés mais je voyais leurs effets : le regard qui se baisse, le silence qui s'installe et la honte qui s'invite.
Avec les années, d'autres mots se sont tournés vers moi, pour ce que je me rappelle on disait que j'étais trop sensible, trop timide, trop susceptible, trop inquiète pour mon âge, que j'avais un très mauvais caractère, en bref j'étais sois trop, sois pas assez ...😉 Un peu comme si ces traits étaient des défauts à corriger, et non des signaux à écouter. J'ai alors compris, à ma manière, ce que les autres avant moi avaient ressenti : le poids des jugements posés sur ce que l'on ne comprend pas.
Toutes ces phrases disent beaucoup, non pas sur celui qui souffre, mais sur ceux qui ne savent pas écouter, elles révèlent une gêne face à ce qui échappe à la raison. On préfère banaliser, réduire, plutôt que d'accueillir ce qui dérange. Parce que, autant le dire clairement, l'anxiété dérange car elle met à jour des émotions que la société préfère cacher : la peur, la tristesse, la vulnérabilité, elle rappelle que sous nos apparences solides il y a des failles, et oui, c'est ça être humain ...!
Longtemps il a fallu rester fort, ne pas se plaindre, ne pas flancher et ne surtout pas montrer ce qui tremble à l'intérieur, dans ma famille (comme dans beaucoup d'autres sûrement) la force était une valeur presque une armure, et l'anxiété elle, passait pour une faiblesse. Alors on l'a tue, on l'a recouverte d'ironie de colère ou de silence, il était plus simple de tenir plutôt que de ressentir.
Dans ma famille, cette injonction à la force a des racines profondes, par les violences subies, par la peur constante, par la faim, par le froid, par la perte, mes grands pères ont dû survivre dans un monde où l'émotion était un danger, où baisser la garde pouvait coûter la vie. Alors ils ont appris à verrouiller leurs émotions, à maîtriser chaque frémissement intérieur, cette vigilance extrême alors nécessaire à leur survie, s'est inscrite en eux... et s'est transmise, d'une manière plus subtile mais tout aussi réelle. Leur peur est devenue prudence, leur tension exigence et leur silence pudeur. Et génération après génération, cette tension s'est glissée dans nos gestes, nos mots, nos corps.
Je crois que l'incompréhension d'aujourd'hui, ces mots durs, "tu penses trop" ; "arrête de tout décortiquer" ; "c'est dans ta tête tout ca" ...ces jugements rapides, sont aussi les héritiers de toutes ces émotions refoulées. On rejette l'anxiété parce qu'elle ravive des mémoires que l'on préfère taire, parce qu'elle vient fragiliser la façade que nos anciens ont construite pour rester debout.
Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que ces mots ont façonné bien plus qu'on ne le croit. Ils n'ont fait qu'entretenir le silence et nourri l'idée qu'il valait mieux taire ce qui pèse.
Et c'est peut être pour cela que j'écris : pour redonner de la valeur à ce qui longtemps n'en a pas eu, pour dire simplement :
"Ce que tu ressens compte" 💛
Les symptômes que l'on cache, ces signes que l'on tait.
Longtemps j'ai pensé que j'étais simplement tendue, nerveuse, fatiguée... comme beaucoup le sont parfois. Je vivais avec cette boule au ventre, ce cœur qui s'emballe sans prévenir, cette respiration courte et ces insomnies que je mettais sur le compte d'un "mauvais passage", de mon caractère trop sensible. Et comme mes parents avant moi, je n'en parlais pas, parce que chez nous on ne se plaignait pas, non, on "tenait bon".
Alors pendant des années j'ai tenu bon. J'ai appris à dissimuler ces symptômes, à serrer les dents et à avancer malgré tout. C'est ce que j'avais vu faire toute mon enfance : avancer sans se plaindre parce que la vulnérabilité n'avait pas sa place, tout simplement.
C'est au décès de mon père, que tous ces signes ont commencé à devenir de plus en plus envahissants, je ne parvenais que difficilement à les contenir, ils semblaient déborder, comme si quelque chose en moi s'était fissuré.
La disparition de mon père a agi comme un déclencheur, il était le dernier lien vivant avec une lignée d'hommes marqués par la peur et la survie, quand il est parti tout un pan de mon histoire s'est effondré. Et, sans que je le comprenne tout de suite, les émotions qu'il avait si longtemps contenues semblaient chercher à se libérer à travers moi. C'est comme si, en son absence, tout ce qui avait été tu depuis des générations réclamait enfin d'être entendu, et l'anxiété s'est installée en moi, insidieusement.
J'ai commencé à ressentir une tension constante, comme si mon propre corps se souvenait de dangers que je n'avais pourtant jamais connus.
Petit à petit les souvenirs sont remontés et je revoyais mon père souvent sur le qui-vive, incapable de se reposer, toujours inquiet pour tout et pour tout le monde. Ma mère qui portait cette inquiétude diffuse qu'elle cachait derrière un sourire où une constante agitation. Et moi, sans même m'en rendre compte, j'avais appris à vivre dans cette vigilance constante, comme eux, comme avant eux.
On l'appelle l'hypervigilance, un état où le corps reste prêt à réagir même quand le danger n'est plus. C'est un héritage invisible, transgénérationnel, et c'est le mien.
Les guerres, les pertes, les traumatismes, tout ce que nos ancêtres ont vécu laissent des traces, non seulement dans les mémoires mais aussi dans les corps.
Plus j'ai essayé de lutter contre cette anxiété, plus elle s'est imposée car à force de vouloir la maîtriser, je lui donnais encore plus de force. J'évitais, je fuyais, je faisais semblant d'aller bien, mais elle revenait plus forte et plus bruyante un peu comme un message que l'on refuse d'entendre.
Je sais aujourd'hui que ces symptômes ne sont pas apparus par hasard, ils sont les échos d'une histoire qui me dépasse. Des émotions que mon père, et avant lui mes grands-pères n'ont pas pu dire, exprimer, pleurer.
Et que, sans le vouloir, j'ai reprises à mon compte.
Alors quand la panique monte sans raison apparente, quand mon corps s'emballe, j'essaie petit à petit, de ne plus la voir comme une ennemie mais comme un signe que quelque chose cherche à se réparer.
Parce que ce que j'ai retenu, c'est que le corps ne ment jamais, il raconte ce que le mental tente d'oublier. Le cerveau peut tout rationaliser, tout expliquer et tout justifier, mais le corps lui, se souvient. Et c'est souvent lui qui nous pousse à regarder enfin, ce qui en silence, attendait d'être reconnu.
Aujourd'hui quand mes mains tremblent, que mon cœur s'emballe où que je ressens cette tension, cette peur, j'essaie de ne plus lutter, j'écoute.
J'écoute mon corps, mes émotions, mon histoire.
Parce que comprendre ces émotions c'est déjà commencer à guérir.

Les mille visages de l'anxiété
L'anxiété n'a pas un seul visage.
Elle peut se cacher derrière de l'hyperactivité, de l'humour, de la colère, de la fatigue, des acouphènes, des problèmes cutanés avec des démangeaisons sévères mais aussi une peur de consulter ses mails, une tension insidieuse lorsque la sonnerie de son portable retentit, parfois elle s'exprime par un simple "je suis tendu" ; "je dors mal" ; "je m'inquiète trop", sans qu'on imagine ce qui se joue derrière.
Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que l'anxiété ne commence pas forcément avec nous, souvent elle s'installe bien avant, dans les gestes, les silences, les attitudes de ceux qui nous ont précédés. Certains ont grandi dans la peur du manque, d'autres dans l'attente du danger et ces émotions, même tues, laissent une empreinte.
Parce que oui, on hérite d'un climat émotionnel autant que d'un nom.
Une manière d'être au monde, de réagir, de se protéger. Et cet héritage là ne se voit pas sur les photos de famille, mais il se ressent dans les corps, parfois même dans nos choix de vie.
Reconnaitre cela, ce n'est pas se condamner à revivre les mêmes peurs, c'est au contraire la première étape pour s'en sortir.
S'autoriser à observer et se demander : qu'est ce que je rejoue sans le vouloir ? Qu'est ce qui m'appartient vraiment ?
L'enjeu n'est pas de chasser l'anxiété, ça ne fonctionne pas ainsi. Plus on cherche à la faire taire, plus elle revient déguisée autrement, dans le corps, les pensées, les insomnies.
Parce que l'anxiété ne nous veut pas de mal, elle veut juste être reconnue, alors elle insiste, elle pousse, elle déborde même, jusqu'au jour où on accepte enfin de la regarder en face, c'est à dire oser l'écouter quand elle se manifeste : accepter de ressentir la peur au lieu de la fuir, remarquer quand le corps se tend, quand la fatigue s'installe, quand le souffle se coupe. C'est s'adresser à elle, apprendre à lui demander : de quoi veux tu me parler ?
Alors peu à peu elle cesse de crier, elle devient un langage à apprivoiser, et c'est souvent là que tout commence.
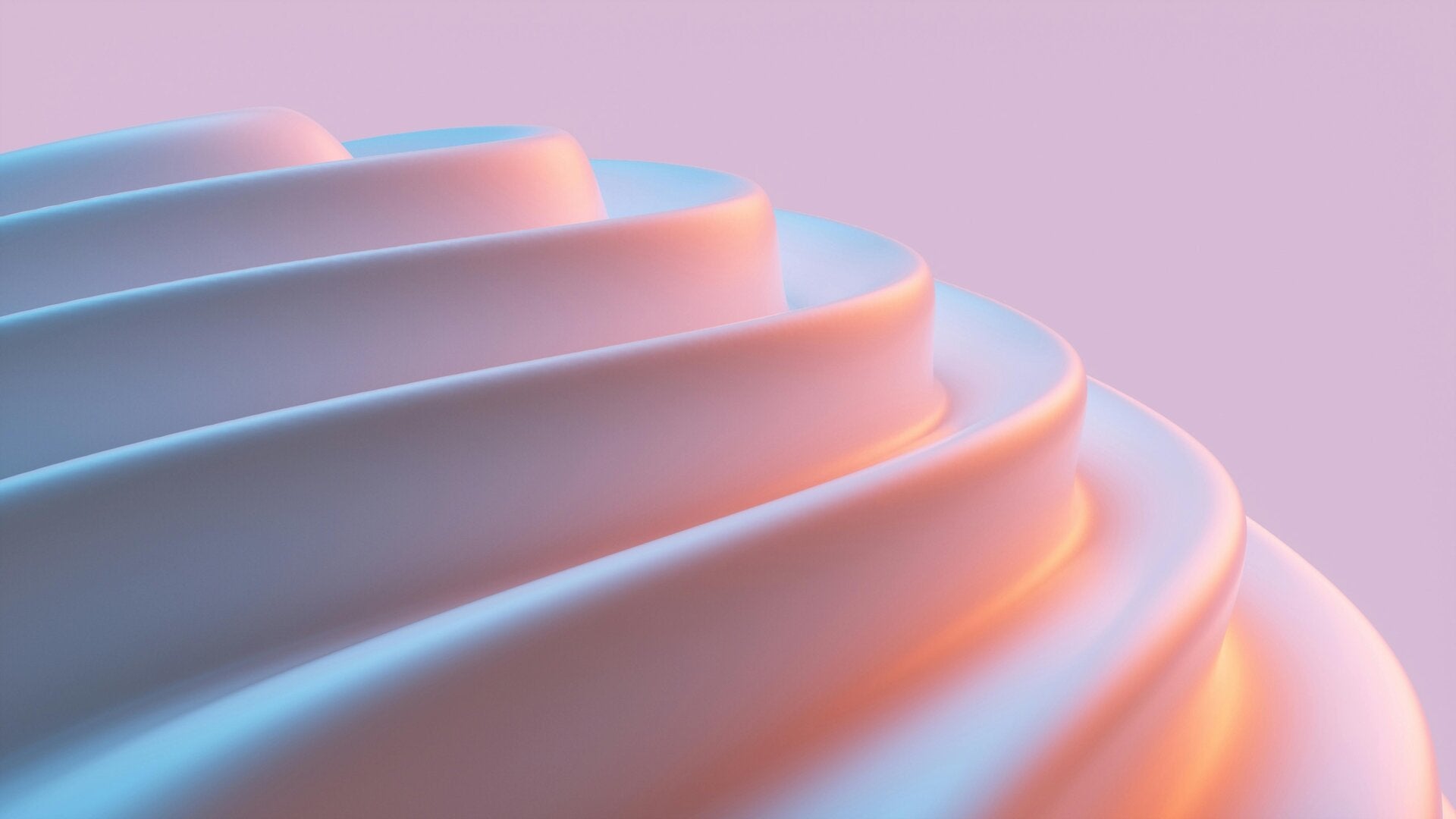
Cycle 2 : L'écho des generations
Il y a des échos qui traversent le temps sans qu'on sache d'où ils viennent.
Des émotions, des peurs, des silences qui s'expriment à travers nous comme un langage transmis de génération en génération.
Dans ces pages, j'essaie de comprendre ce que ces voix familiales me racontent encore.
Quand les vérités se dévoilent.
Il arrive un moment où tout ce qu'on croyait savoir sur sa famille se fissure.
Ce moment, pour moi, s'est produit plusieurs mois après le décès de mon père, un matin, en plongeant dans les vieilles photos de famille. Je n' ai pas découvert de secret et pour être honnête, je les connaissais déjà ces photos, mais ce jour là je les ai regardées différemment. Non plus à travers ce que moi j'avais vécu uniquement, mais à travers ce que chacun avait porté en silence.
Ces gestes que j'avais pris pour de la froideur mais qui étaient peut être de la peur, ces silences qui contenaient peut être plus de douleur que d'indifférence.
Et j'ai compris à quel point chacun, à sa manière, avait fait comme il pouvait avec ce qu'il avait reçu.
Si ce regard nouveau ne change rien au passé, il adoucit quelque chose en moi, comme si je pouvais enfin regarder ma famille autrement, avec plus de compréhension, sans chercher à tout expliquer ni à tout excuser.

Ce que l'héritage m'a appris sans le dire.
J'ai toujours eu énormément de tendresse et de respect pour mes grands-parents, ils ont traversé des épreuves dont je n'ai pas toujours mesuré la portée, leur histoire semblait lointaine presque figée dans les récits familiaux.
Du côté maternel mon grand père avait servi longtemps loin des siens dans des pays qu'il évoquait parfois avec ses petits enfants. C'était un homme solide et sensible à la fois, capable d'élans de tendresse comme de colères soudaines, peut être parce qu'il portait en lui ce que les mots ne pouvaient pas apaiser. Ma grand-mère, elle, avait quitté son pays pour venir en France, élevant seule ses enfants pendant les absences de son mari, elle avait la vitalité de ceux qui n'ont pas le choix et la fierté de ceux qui doivent tenir.
Lorsque mon grand-père s'est retrouvé sédentaire du fait de sa retraite, il est peu à peu devenu silencieux perdu dans ses pensées, derrière sa forte carrure il y avait cette tristesse sourde qui parfois semblait prendre toute la place et ce, malgré tous les efforts de ma grand-mère vive et volontaire, pour le ramener à la vie. Il se retirait souvent dans sa chambre, comme si le silence lui pesait moins que le monde autour de lui.
Du côté paternel l'histoire n'était pas très différente.
Mon grand père prisonnier avait connu la faim, le froid l'humiliation et la peur, il était revenu vivant, mais vidé de mots. C'était un homme taciturne, généreux et sensible, qui avait trouvé dans sa retraite un refuge simple : son garage, son établi et ses outils bien rangés, s'il encourageait ma grand mère à sortir lui aimait sa tranquillité loin du bruit, préférant le calme à la compagnie. Derrière cette sérénité apparente, il portait le poids des années de captivité très éprouvantes dont il ne parlait jamais. J'avais pu surprendre quelque fois des brides de conversation entre ma grand- mère et ses amies, elle racontait qu'il avait tellement souffert de la faim qu'à son retour il vidait la poubelle de la cuisine pour récupérer les épluchures des pommes de terre.
A demi mots, les yeux brillants elle évoquait du bout des lèvres, les humiliations, la peur et le froid.
Ces messes basses, ces visages graves à l'évocation de cette période avaient suffi à me faire comprendre que les souffrances restaient très présentes et qu'il ne fallait pas les réveiller, alors je n'ai jamais osé braver l'injonction implicite du silence qui m'était imposé.
Mes parents ont appris très jeunes à ne pas ajouter de douleur à celle qui existait déjà, cachant leurs émotions, ne voulant peiner ni leur père ni leur mère qui avait géré seule leur quotidien. Chacun d'eux, à sa manière, respectait un contrat moral tacite : ne pas déranger, ne pas montrer et maintenir une forme de vigilance constante pour éviter la peur du manque et de l'imprévisible.
Quand à moi, j'ai grandi entre ces deux mondes, entre le besoin de tout contrôler et celui d'aimer sans mesure, entre la peur et la tendresse.
Les années ont passées je suis devenue maman à mon tour, et c'est en me regardant agir avec les miens que j'ai compris combien tout cela vivait encore en moi. Mes réactions, mes inquiétudes, mes élans de protection... tout cela racontait une histoire plus ancienne que la mienne.
Ce n'était pas seulement une histoire de souvenirs : c'était une mémoire émotionnelle, inscrite dans mon corps.
Cet héritage ne m'a rien dit avec des mots, mais il m'a tout appris : la loyauté, la pudeur et le courage.
Et c'est en écoutant cette histoire silencieuse que j'ai compris que le chemin vers l'apaisement ne passait pas par l'oubli mais par la reconnaissance.
Quand le corps se souvient
Pour moi l'anxiété était une sorte de prédisposition familiale, dans ma famille chacun à sa manière composait avec ses angoisses et ses insomnies, c'était presque banal, on disait : "on est comme ça" , sans chercher plus loin.
Et pourtant, très jeune, quelque chose en moi semblait déjà vouloir comprendre.
Qu'est ce qui peut bien pousser une adolescente de 13, 14 ans à s'intéresser soudainement à la partie la plus sombre de la Seconde Guerre Mondiale : les camps d'extermination ?
Je ne le savais pas encore mais quelque chose en moi me guidait déjà vers cette quête silencieuse. A cet âge-là, je passais des heures à lire, à chercher, à classer des informations sur ces lieux de mémoire que je consignais ensuite dans un cahier, comme si comprendre pouvait apaiser une question muette. Mes parents ne comprenaient pas cet intérêt, mais ne s'en inquiétaient pas non plus, pour eux ce n'était qu'une curiosité un peu étrange certes, mais qui passerait avec l'âge. J'ai pourtant poursuivi mes recherches bien au delà de ce qu'ils imaginaient, jusqu'à mes 18 ans environ, et contrairement à ce qu'ils pensaient "ça" n'est pas passé, au contraire quelque chose en moi semblait vouloir aller toujours plus loin, un peu comme si une part de moi refusait d'oublier.
Je savais qu'il ne fallait pas poser de questions à mon grand père paternel, ce silence là je l'avais bien intégré. Ce n'était pas comme un secret de famille au sens concret par exemple, mais plus une atmosphère émotionnelle, comme un ressenti inexplicable. Alors j'ai cherché autrement, à travers les livres, les documentaires, les récits d'autres vies, je voulais comprendre cette période puisque tout autour de moi, le silence régnait.
Et bien des années plus tard mon corps, lui, s'est mis à parler.
Les tensions, la fatigue, l'hypervigilance, tous ces états que je pensais anodins ou passagers sont devenus mon quotidien. Mais je continuais à tenir bon car j'étais sûre qu'il y avait mille et une bonnes raisons à ces manifestations : le travail, les soucis du quotidien, le décès de ma mère puis celui de mon père, à chaque fois je reprenais le discours familial qui m'avait construit : " fais abstraction... ça va passer... serre les dents..."
J'avais cette croyance profondément ancrée, comme beaucoup d'ailleurs, que le mental devait dominer le corps et qu'il suffisait de se raisonner pour aller mieux, alors j'ai ignoré ces signaux, comme beaucoup l'avaient fait avant moi. Jusqu'au jour où mon corps n'a plus su contenir, et dans ce débordement une intuition familière, longtemps étouffée a refait surface, comme si une part de moi savait que cette anxiété n'était pas née de moi seule.
Progressivement j'ai réalisé que ma quête d'autrefois n'était peut être pas si éloignée de celle qui s'imposait à moi aujourd'hui. A travers mes lectures d'adolescente je cherchais déjà à comprendre ce que les générations d'avant avaient vécu, et aujourd'hui c'est à travers mon propre corps que la même question se rejouait.
Alors j'ai commencé à chercher à nouveau, mais ailleurs cette fois et c'est en découvrant un article sur l'épigénétique que les choses ont commencé à prendre un sens nouveau. J'ai tâtonné, j'ai relié, cherché des ponts entre ce que mon corps exprimait et ce que ma lignée avait traversé. Je n'ai pas trouvé de certitude, seulement des pistes, des correspondances, des fragments de sens qui semblaient juste vouloir me dire : "arrête de vouloir comprendre, commence à écouter ..."

Les femmes de ma famille

Avant de comprendre ce que je portais en moi, j'ai dû me tourner vers elles, les femmes de ma famille.
Celles qui ont tenu, aimé et souffert en silence, celles qui sans le savoir m'ont transmis bien plus que leur histoire.
Mes grands-mères étaient des femmes de caractère, autoritaires même parfois, mais c'était sans doute ce qu'il fallait pour traverser la guerre, élever leurs enfants seules et tenir malgré tout. Elles ont porté des charges lourdes sans se plaindre, habituées à taire la fatigue, la peur et la douleur. Leur force imposait le respect mais derrière cette solidité il y avait aussi beaucoup de solitude.
Elles ont vécu dans un monde où il fallait être courageuse, où montrer ses émotions était une faiblesse, elles n'avaient pas le choix.
Ma mère, elle, a grandi dans un autre contexte puisque née après la guerre. Si elle n'a pas souffert des privations, elle a malgré tout grandi dans une atmosphère encore marquée par l'inquiétude et les non-dits, une enfance marquée par par l'absence d'un père reparti combattre en Indochine, une absence qui planait sur le quotidien. Peut être que ce manque a nourri en elle un besoin profond de vivre, de ressentir et d'exister autrement.
Elle rêvait d'ailleurs, d'expériences nouvelles, de liberté, de grands espaces, elle refusait l'idée même d'une vie toute tracée par les obligations, les sacrifices. Mais derrière son tempérament de feu, il y avait une profonde anxiété, une peur de la mort, de la nuit, une sorte d'agitation intérieure qu'elle ne parvenait pas à apaiser. Enfant je ne mettais pas de mots sur ce que je percevais, mais je sentais cette peur diffuse, constante, qui faisait partie de notre quotidien, une peur que l'on tait parce qu'on ne sait pas d'où elle vient.
Et moi, j'ai grandi entre ces deux modèles : la force des femmes qui cachaient leurs peines derrière l'action et le courage et la révolte de celle qui voulait vivre autrement.
Longtemps j'ai cru devoir choisir entre ces deux héritages : me taire ou fuir.
Aujourd'hui je commence seulement à comprendre qu'il existe une autre voie : écouter, accueillir et peu à peu mettre des mots là où depuis des générations, il n'y en avait pas.
L'héritage de la première place
Dans les familles, la place que nous occupons n'est jamais neutre, elle s'inscrit dans une histoire plus vaste, celle de ceux qui nous ont précédés. Etre l'aînée ce n'est pas seulement naître la première mais c'est souvent, inconsciemment, hériter d'une mission : celle de "tenir", de "faire face" et de "veiller".
Chez moi cette place semblait aller de soi, sans qu'on ait besoin de me le dire, j'ai compris très tôt que je devais être celle sur qui on pouvait compter. Une loyauté silencieuse qui s'est installée comme une évidence, pourtant avec le recul, je mesure à quel point elle s'est tissée bien avant moi.
Mon père aussi était l'aîné, enfant il s'est retrouvé seul avec sa mère dans un contexte de guerre où il fallait bien se montrer courageux et ne surtout pas inquiéter davantage les adultes. Très jeune il a appris à se taire, à se rendre utile et à se tenir droit, une posture d'endurance que j'ai reçue en héritage, et ce que mon père avait appris dans l'urgence et la peur j'ai fini par l'intégrer comme une manière normale d'être au monde.
C'est là que la transmission devient invisible car elle ne passe pas seulement par les mots mais aussi par les attitudes, les émotions et les silences. Mon corps a reproduit le même schéma c'est à dire, la tension, la vigilance, cette impression de devoir tout anticiper pour éviter les tumultes. Et c'est souvent dans ce terrain que l'anxiété prend racine, celle d'une loyauté inconsciente envers les générations qui ont dû se battre pour survivre.
L'aîné, souvent, porte la mémoire de ce qu'il faut maintenir debout, il devient le garant symbolique de la cohésion familiale et cette responsabilité implicite se manifeste plus tard dans la difficulté à lâcher prise, à demander de l'aide et à simplement reconnaitre sa propre vulnérabilité. Ce n'est pas un hasard si tant d'aînés développent des troubles anxieux, des insomnies, une hypervigilance diffuse, c'est que leur système nerveux a appris à rester en alerte pour protéger les autres.
Reconnaitre cette trace transgénérationnelle, ce n'est pas accuser ni s'enfermer dans le passé mais c'est comprendre et redonner du sens à des comportements qui semblaient figés. Aujourd'hui je commence à percevoir cette place autrement, certes elle reste liée à la force, mais une force différente, celle de la conscience.
Comprendre c'est déjà alléger, je ne veux plus être seulement celle qui tient, j'apprends aussi à être celle qui ressent et qui s'autorise. C'est peut être cela la vraie transmission au fond : transformer la force héritée en liberté intérieure.

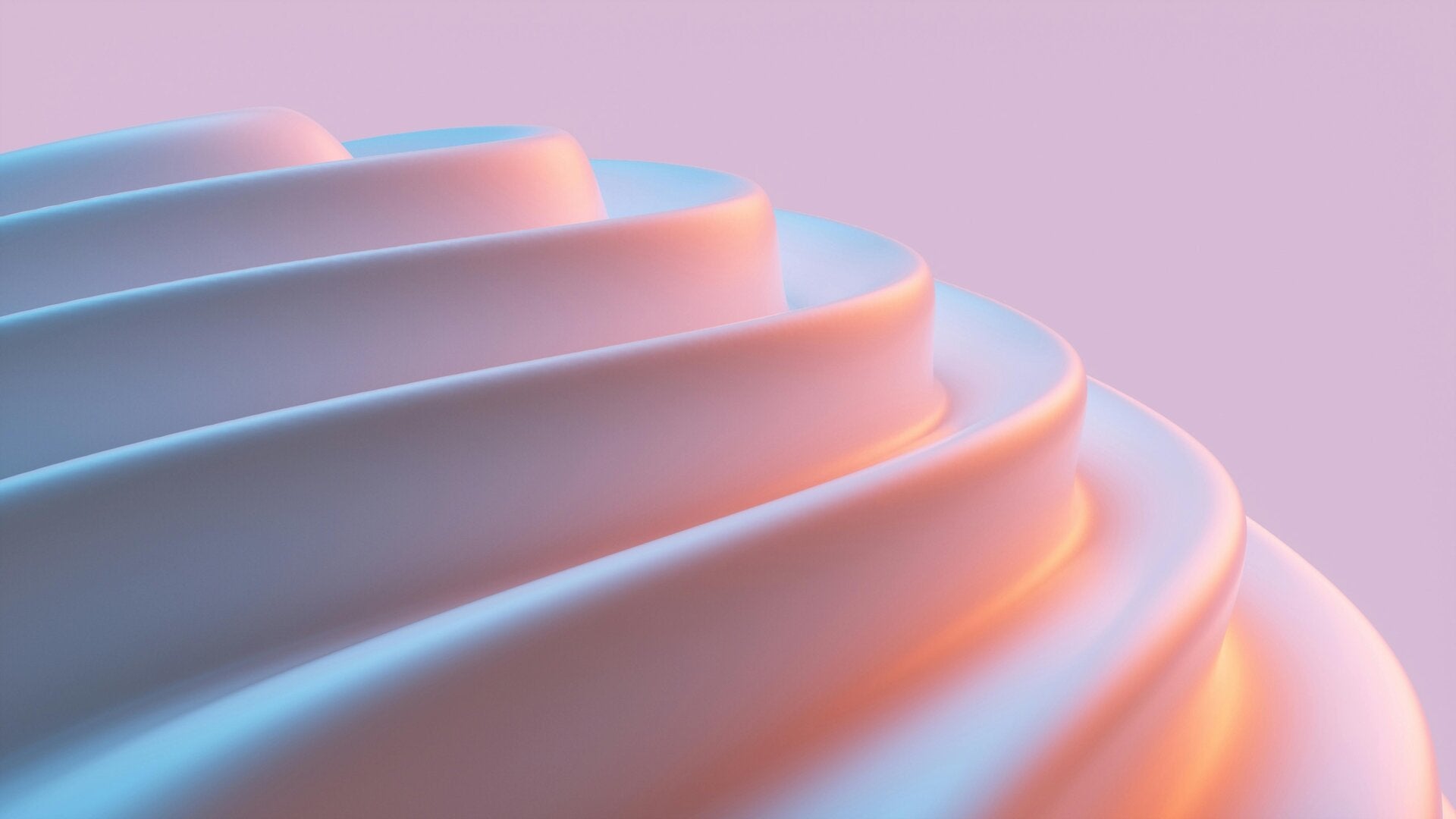
Cycle 3 : quand l'histoire familiale ecrit mes choix
Dans ce cycle, j'explore la manière dont mon histoire familiale continue d'influencer mes décisions, mes réactions et mes relations.
Parfois, sans m'en rendre compte, je rejoue des mécanismes transmis, des façons de faire qui sont héritées et je réalise que mes choix restent liés, quelque part, à tout ce qui m'a précédée.
La peur du manque

Je me souviens très bien de chaque rentrée scolaire.
Pour moi c'était un moment important, un petit rituel intérieur où je rêvais de la plus belle trousse, de tous ces crayons parfumés à la pomme et de ces gommes en forme de cœur qui faisaient briller les yeux de toutes les petites filles. Ce n'était pas que du matériel, c'était un moyen d'exprimer qui j'étais, ce que j'aimais et ce qui me faisait plaisir. Mais chaque année le scénario se répétait, au final c'était toujours mon père qui tranchait et décidait de tout, il choisissait des articles solides et fonctionnels " sans chichis et qui dureraient toute l'année", pas de place pour le beau et la fantaisie.
Avec lui, on ne gaspillait pas et on cédait encore moins aux envies "futiles", on faisait ce qui était raisonnable, il reprenait le contrôle de la liste scolaire et disait sans méchanceté " garde ce qui est utile, le reste ne sert à rien". Ce n'était pas dit avec dureté, ce n'était même pas une interdiction, c'était juste sa manière de faire qui était portée par une vigilance intérieure qui ne le quittait pas, c'était sa manière d'être au monde.
La petite fille que j'étais alors comprenait déjà que ce n'était pas une affaire d'argent car matériellement nous ne manquions de rien, mon père gagnait bien sa vie. Il m'a fallu des années pour réaliser que chez lui la peur du manque était ailleurs, c'était la peur que tout se brise, la peur que le plaisir détourne de l'essentiel, la peur surtout d'être pris au dépourvu, comme une prévoyance constante, un réflex. Moi, enfant, j'apprenais sans le savoir que le désir pouvait être un excès, que le beau était secondaire et que ce que je voulais n'avait pas réellement de place. Moi aussi j'apprenais à choisir "ce qui dure" pas "ce qui me plaît". J'apprenais à faire attention, à ne pas gaspiller, à ne pas trop demander. En fait sans le savoir, j'apprenais la peur du manque, la sienne et bientôt la mienne ...
La peur du manque ne se limite pas aux questions matérielles, c'est une peur beaucoup plus vaste et sourde qui s'insinue dans les choix du quotidien comme par exemple, acheter en fonction de l'efficacité plutôt que du goût, garder "au cas où", anticiper toujours le pire plutôt que profiter du moment présent. C'est une peur qui pousse à contrôler tout pour ne pas souffrir, qui prend la forme de la prudence excessive et qui finit par prendre la place du désir, en somme une peur qui choisit à notre place.
Ce n'est pas en relisant le passé que j'ai compris, mais en me regardant vivre au quotidien, en remarquant cette façon de trop prévoir, de vouloir maîtriser, de dire oui parfois alors que mon corps criait non. Quelque chose d'ancien se rejouait, un héritage qui s'était glissé en moi et qui continue de m'habiter un peu, aujourd'hui.
Ce que mon père m'a transmis n'a jamais été dit, jamais expliqué, ce n'était pas non plus une injonction ni une éducation volontaire, c'était un climat intérieur, un rapport au monde construit bien avant moi. Aujourd'hui comprendre la peur du manque ce n'est plus la juger, c'est comprendre qu'elle a été un modèle de protection transmis avec amour. Mais c'est aussi reconnaitre que je peux m'en défaire en apprenant progressivement à faire une place à ce qui ne sert à rien sinon à me faire du bien, à accueillir mes désirs sans les classer en "utile" ou "inutile" c'est redonner de la place au choix et au plaisir.

" Quand on veut, on peut "
Certaines phrases s’infiltrent dans l’enfance comme des vérités absolues, des phrases que l’on finit par porter comme une seconde peau, sans jamais vraiment se demander si elles sont justes, si elles nous font grandir ou si elles nous abiment un peu.
« Quand on veut, on peut » cette phrase c’était celle de mon père, comme un refrain ou comme une évidence.
Comme tous les enfants j’ai longtemps cru que les parents détenaient la vérité, alors à chaque fois que je revenais de l’école avec une mauvaise note ce n’était pas seulement une déception que je ressentais ; c’était un jugement, si j’avais échoué, c’est que je ne m’étais pas assez investie. Dans ma tête d’enfant cette phrase effaçait tous mes efforts elle ne laissait aucune place à l’apprentissage, elle disait juste : si tu n’as pas réussi, c’est que tu ne l’as pas voulu assez fort c’est tout !
Et grandir avec cette croyance c’est grandir avec une pression invisible mais constante, c’est apprendre très tôt que l’erreur n’a pas le droit d’exister. C’est intérioriser que l’échec n’est pas normal, qu’il n’est pas une étape, non. Si l’échec arrive c’est que toi tu n’es pas assez.
Alors l’enfant que j’étais a développé une certitude : je devais mériter la réussite, mériter l’amour, mériter la fierté et si je n’y arrivais pas c’était forcément de ma faute.
Cette phrase a façonné une base fragile faite de doute et de culpabilité qui a grignoté peu à peu toute confiance en moi. En grandissant elle est revenue se glisser dans ma vie d’adulte : j’échouais à un examen, j’étais recalée au permis de conduire, je bafouillais à un entretien d’embauche … c’était toujours la même conclusion automatique et implacable : je n’avais pas voulu assez, comme si vouloir pouvait tout résoudre.
Et puis je suis devenue maman et en regardant grandir l’un de mes fils, neuro-atypique et sa façon unique d’apprendre, j’ai commencé à mesurer l’injustice de cette vieille phrase que j’avais reçue. Comment aurais-je pu lui dire à lui : « Quand on veut on peut » ? Comment aurais-je pu nier ce qu’il vivait, ce qu’il ressentait, l’énergie qu’il déployait pour comprendre une émotion, un code social ?
En l’observant j’ai réalisé que vouloir n’a jamais suffi, que la volonté n’efface ni les particularités, ni les peurs, ni les fragilités d’un enfant et que l’amour, lui, ne demande pas de performance. Il m’a obligée, sans le savoir, à remettre en question tout ce que j’avais intégré comme des vérités absolues. A comprendre que l’on peut vouloir très fort… et que cela ne garantit rien et que l’effort mérite d’être vu pour ce qu’il est : du courage, pas une preuve de valeur. C’est son regard et sa façon d’être au monde qui m’ont donné accès à une dimension que je n’avais jamais envisagée : celle où l’enfant n’a pas à mériter sa place, sa réussite, son droit à l’erreur, où il n’a pas à prouver qu’il vaut assez.
En revisitant cette phrase « quand on veut, on peut » j’ai compris qu’elle n’était pas seulement un souvenir de mon enfance, c’était un héritage.
Un héritage transmis sans conscience, comme on transmet un objet de famille dont on ignore le poids.
Mon père me l’a répétée parce qu’on la lui avait certainement répétée et je pense sincèrement qu’il était persuadé qu’elle forgeait le caractère, qu’elle préparait à la vie. Il n’a jamais imaginé qu’elle pourrait me blesser, me diminuer. Dans sa bouche c’était juste une règle du monde alors que dans mon cœur d’enfant c’était une sentence.
C’est précisément ça le transgénérationnel : des mots, des croyances, des peurs, des modèles éducatifs que l’on transmet comme des vérités, jusqu’au jour où quelqu’un s’arrête et demande « Est-ce vraiment juste ? Est-ce vraiment aidant ? Est-ce que je veux continuer ça » ?
Ce quelqu’un pour moi, ça a été mon fils. En le voyant grandir avec sa sensibilité et son chemin si particulier, j’ai compris que je ne pouvais plus transmettre ce que j’avais moi-même reçu sans le questionner. Je ne pouvais pas lui offrir la même injonction et la même confusion entre vouloir, réussir et exister. Alors j’ai commencé à déconstruire, à remettre en lumière et à transformer.
C’est peut-être ça devenir adulte, oser regarder ce que l’on a reçu, reconnaitre ce qui fait mal et choisir en conscience ce que l’on souhaite transmettre ou arrêter. Aujourd’hui je n’ai pas toutes les réponses, mais je suis devenue un pont : entre ce que ma famille m’a transmis et ce que mes enfants méritent de recevoir.
Il est là le cœur de mon chemin, transformer l’héritage émotionnel pour qu’il devienne plus léger, plus juste, plus humain.
" Ne fais pas tant d'histoires "

J'ai huit ans.
Je vis une enfance de rêve dans un pavillon de banlieue, entouré de champs et de vastes prairies.
Je vais à l'école à pied avec les autres enfants et le mercredi on part à vélo à travers la campagne, on se gave de mûres sauvages et de pommes vertes, on construit des cabanes dans les arbres et on rentre les genoux sales, écorchés et la tête pleine d'aventures. Je suis une enfant insouciante, heureuse, très proche de mes grands-parents maternels qui représentent pour moi un refuge, une stabilité douce.
Puis, sans qu'aujourd'hui encore je n'ai le souvenir d'une véritable explication, tout bascule.
Mon père démissionne de son travail pour accepter un poste à des milliers de kilomètres, loin, très loin de ma vie d'alors.
Nous sommes en 1976, j'ai huit ans, je prends l'avion pour la première fois et je quitte mon monde, mes repères et ma sécurité. L'insouciance s'arrête là, précisément à ce départ.
A huit ans, je n'ai pas les mots pour comprendre ce qui se joue, je ne discute pas, je ne proteste pas, je fais ce que font beaucoup d'enfants je m'adapte. Je range ma peur quelque part et j'apprends à être sage, à ne pas compliquer les choses et surtout à ne pas ajouter du bruit à une décision qui me dépasse.
Ce départ je ne l'ai pas vécu comme une injustice exprimable, mais comme quelque chose à encaisser. Et très vite quelque chose s'est mis en place en moi : Il fallait s'adapter, ne pas compliquer les choses, ne pas ajouter de peine, ne pas être un problème de plus. Alors j'ai appris à me plier et à contenir ce qui débordait à l'intérieur et à m'ajuster à ce qui était décidé pour moi.
Avec le recul je vois combien cette capacité d'adaptation était aussi une façon de survivre émotionnellement, mais à huit ans je n'avais que cette sensation diffuse qu'il valait mieux ne pas faire d'histoires.
Ce n'était pas une phrase répétée à voix haute, mais plutôt une ambiance, une règle invisible.
Des années plus tard, j'ai découvert l'analyse transactionnelle et j'ai compris que ce type de message fait partie de ce que l'on appelle une injonction. C'est à dire pas un ordre explicite, mais un message profond, implicite que l'enfant intègre pour préserver le lien avec ses parents.
Mon injonction "ne fais pas d'histoires" a appris à l'enfant que j'étais que ses émotions, ses besoins, ses colères, pouvaient déranger, alors il a appris à les taire. Il est devenu raisonnable, adaptable... parfois au prix de lui-même.
Cette injonction a façonné une grande partie de ma vie intérieure, elle m'a appris à ne pas déranger, à encaisser et à toujours minimiser ce que je ressentais.
Mais un enfant qui n'a pas le droit de faire des histoires devient souvent un adulte qui a du mal à prendre sa place, un adulte qui doute de la légitimité de ses émotions. Un adulte qui culpabilise lorsqu'il exprime un désaccord, une fatigue ou une souffrance.
Ce que je n'avais pas compris enfant, c'est que partir loin avait été une véritable rupture intérieure pour moi. Je n'avais pas les ressources pour la penser alors je l'ai encaissée silencieusement.
Aujourd'hui je vois combien cette injonction s'est rejouée plus tard dans mes choix, mes relations, mon rapport au travail, à la responsabilité, au conflit. Dire non était difficile, demander était compliqué et exprimer une colère me semblait dangereux.
Ce travail de mise en mots, je ne l'ai pas fait d'un coup. Il s'est construit lentement à travers l'observation de mes propres réactions, de mes blocages, mais aussi et surtout en regardant grandir mes enfants. En voyant combien un enfant a besoin que ses émotions soient accueillies pour ne pas avoir à les étouffer.
Aujourd'hui écrire ce texte est une manière de réparer quelque chose. Non pas en accusant, mais en comprenant. En reconnaissant l'enfant que j'ai été, celle qui a fait de son mieux avec ce qu'elle avait.
Avec douceur et conscience je comprends que ressentir, dire questionner ce n'est pas faire des histoires, c'est simplement être vivant.

Porter sans bruit
Avant notre déménagement, la vie avait ses repères, mon père était présent, ma mère voyait sa famille, ses amies, et moi j'étais heureuse avec ma petite bande. Il y avait parfois quelques tensions mais il y avait surtout des liens, des habitudes, et un quotidien qui faisait socle.
C'est après le déménagement que les choses sont devenues compliquées, moi j'avais dû dire quitter tout ce qui me reliait, tout ce qui me sécurisait, mon père quand à lui face à ce nouveau travail pour lequel il avait tout à prouver, travaillait sans relâche et était absent de plus en plus souvent. Ma mère, elle, se retrouvait seule, loin de sa famille, de ses amies, isolée de tout, et c'est la solitude qui a alors pris toute la place tant près de ma mère que de la petite fille que j'étais.
C'est à cette époque que j'ai commencé à porter, pas par choix mais par nécessité,
Petit à petit les tensions ont commencé à surgir à la maison et entre mon père accaparé par son nouveau travail et ma mère qui souffrait de la solitude et de l'absence autant dire que personne ne pensait à me demander comment j'allais, on attendait juste de moi que je m'adapte à ce nouvel environnement sans faire de vagues.
Alors j'ai porté, j'ai porté tout ce qui n'avait pas de place ailleurs. La tristesse, la solitude, l'angoisse, sans rien dire, là prenait sens, l'héritage de la première place. A 8 ans j'étais bien incapable de conscientiser la stratégie que je mettais en place, et encore moins de la nommer, à 8 ans on s'organise juste, on s'ajuste et on survit.
Ce portage silencieux a continué de m'accompagner à l'adolescence puis à l'âge adulte, dans mes choix, mes relations et toujours ma manière d'être au monde.
Aujourd'hui, 50 ans plus tard, je commence à mettre des mots sur ce que j'ai porté si longtemps. A comprendre que ce n'était pas "moi" mais juste une manière apprise très tôt de tenir l'équilibre autour de moi, une stratégie de survie en somme.
Je ne renie rien de ce qu'elle m'a permis, elle m'a aidée à tenir quand il fallait tenir, à rester debout dans ces moments où il n'y avait pas d'autres choix que de s'adapter, elle m'a appris très tôt la responsabilité, l'attention à l'autre, la capacité à encaisser sans bruit.
Je sais qu'elle m'a protégée et qu'elle m'a donné une place, une utilité, une certaine solidité.
Aujourd'hui je peux reconnaitre tout cela sans rejeter ni glorifier.
Mais je peux aussi maintenant juste me poser cette question :
Ai-je encore besoin de porter seule ?
Créez votre propre site internet avec Webador